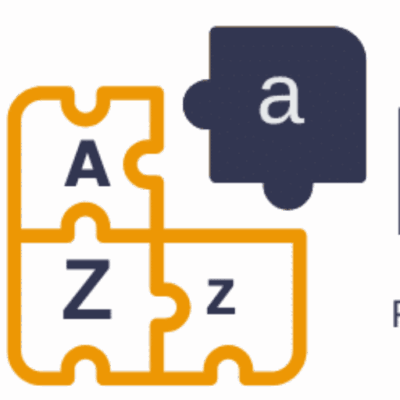Quand j’ai découvert le dispositif « Devoirs faits » au collège de mes enfants, j’ai d’abord ressenti un véritable soulagement. Finis les conflits du soir autour des exercices de mathématiques ! Pourtant, après quelques mois d’utilisation, des questions se posent sur l’efficacité réelle de ce programme. Entre promesses gouvernementales et réalité du terrain, ce dispositif aide-t-il vraiment tous les élèves ou creuse-t-il davantage le fossé entre eux ?
L’ambition initiale du dispositif « Devoirs faits »
Lancé comme une promesse phare du quinquennat, le dispositif « Devoirs faits » visait à réduire les inégalités scolaires en offrant aux collégiens un cadre encadré pour réaliser leurs devoirs. Avec un investissement conséquent de 220 millions d’euros, l’objectif semblait clair : permettre à tous les élèves de bénéficier d’un accompagnement, indépendamment de leur contexte familial.
Ce programme répond à une problématique bien identifiée par les associations de parents d’élèves depuis des années : les devoirs à la maison accentuent les disparités entre les enfants. D’un côté, ceux qui peuvent compter sur l’aide de leurs parents ou de cours particuliers, de l’autre, ceux qui se retrouvent livrés à eux-mêmes face à des exercices parfois mal compris.
En théorie, ce temps d’étude accompagnée devait permettre de :
- Offrir un cadre propice à la concentration
- Garantir la présence d’adultes qualifiés pour répondre aux questions
- Alléger la pression sur les familles en fin de journée
- Réduire le recours aux services privés de soutien scolaire
Pourtant, en visitant différents établissements dans le cadre de mon association de parents d’élèves, j’ai constaté que la mise en œuvre variait considérablement d’un collège à l’autre, créant paradoxalement de nouvelles formes d’inégalités.
Des disparités persistantes dans l’application du programme
En participant aux conseils d’administration de plusieurs établissements, j’ai pu observer que « Devoirs faits » prenait des formes très différentes selon les collèges. Le vademecum ministériel de 42 pages laisse une large autonomie aux équipes pédagogiques, ce qui, loin d’être un avantage, crée de nouvelles disparités territoriales.
La qualité de l’encadrement varie considérablement selon les ressources disponibles. Dans certains établissements, ce sont des enseignants expérimentés qui assurent ces heures, tandis que dans d’autres, on fait appel à des assistants d’éducation ou des volontaires en service civique, parfois moins formés aux enjeux pédagogiques.
| Type d’encadrement | Avantages | Limites |
|---|---|---|
| Enseignants | Expertise pédagogique, connaissance du programme | Disponibilité limitée, coût plus élevé |
| Assistants d’éducation | Bonne connaissance des élèves | Formation pédagogique variable |
| Volontaires service civique | Motivation, proximité générationnelle | Peu d’expérience, turnover important |
Les contraintes logistiques pèsent également lourd. Les horaires choisis – souvent pendant la pause méridienne ou en fin de journée – ne respectent pas toujours le rythme biologique des adolescents. Comment espérer qu’un élève se concentre efficacement sur ses devoirs quand il doit sacrifier son temps de repas ou rester après une journée déjà chargée ?
J’ai rencontré plusieurs parents dont les enfants ne peuvent pas bénéficier du dispositif à cause des horaires de transport scolaire incompatibles. Une mère m’a confié : « Mon fils serait volontaire, mais comment faire quand le dernier bus part à 17h15 ? »
Quand les devoirs masquent un problème plus profond
En discutant avec des enseignants lors de nos réunions, une question fondamentale émerge : pourquoi tant d’élèves ont-ils besoin d’aide pour leurs devoirs ? Si une notion n’est pas comprise en classe, est-il pertinent de la reporter sous forme d’exercices à faire ailleurs ?
D’après une enquête menée en 2023 par le ministère de l’Éducation nationale, seuls 38% des élèves participant au dispositif « Devoirs faits » estiment mieux comprendre leurs cours grâce à ce temps dédié. Ce chiffre interroge sur l’efficacité réelle du programme.
Les causes de cette situation sont multiples :
- Des programmes scolaires souvent trop denses
- Des effectifs par classe qui limitent l’attention individuelle
- Une conception des devoirs parfois déconnectée des capacités d’autonomie réelles des élèves
- Un manque de formation des intervenants aux méthodes d’apprentissage différenciées
Certains pédagogues, comme Laurent Fillion des Cahiers pédagogiques, suggèrent que le véritable enjeu n’est pas tant d’aider les élèves à faire leurs devoirs que de repenser la place du travail personnel dans l’apprentissage. Pourquoi ne pas intégrer davantage ces moments de consolidation et d’appropriation au sein même des cours ?
Vers un nouveau modèle de soutien scolaire
Plutôt que de perpétuer un système qui externalise les difficultés d’apprentissage, ne serait-il pas plus pertinent de repenser notre approche des devoirs ? En tant qu’ancienne enseignante et mère de deux collégiens, je constate que les meilleurs moments d’apprentissage se produisent quand les enfants sont engagés dans des activités qui font sens pour eux.
Des alternatives existent et mériteraient d’être analysées plus largement :
L’intégration de temps d’études dirigées dans l’emploi du temps quotidien permettrait aux élèves de bénéficier d’un accompagnement au moment où leur concentration est optimale. Des plages horaires dédiées à la lecture libre et aux projets personnels développeraient l’autonomie et le goût d’apprendre, bien au-delà de la simple exécution d’exercices.
Repenser les devoirs, c’est aussi rééquilibrer la relation entre familles et école. Avec mon expérience de parents, nous souhaitons être impliqués dans la scolarité de nos enfants, mais pas au prix de tensions quotidiennes autour des cahiers. Notre rôle n’est pas de nous substituer aux enseignants, mais d’encourager, de valoriser les efforts et de créer un environnement propice à l’épanouissement intellectuel.
Le dispositif « Devoirs faits » représente une avancée, mais reste une réponse partielle à un problème plus systémique. Pour véritablement réduire les inégalités scolaires, c’est toute notre conception du travail personnel des élèves qui mérite d’être revisitée.